 Les calculateurs
Les calculateurs 
 Les calculateurs
Les calculateurs 
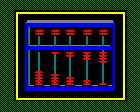
Nous ne nous attarderons pas ici à l'importance, dans l'histoire des numérations, de la découverte du zéro. Ce sujet déborderait des cadres de cette étude. Contentons-nous toutefois de rappeler que seule la numération de position et l'utilisation du zéro permettra la réalisation de calculs abstraits. Nous emprunterons le zéro aux indiens en même temps que les chiffres arabes. La civilisation indienne aurait découvert le zéro il y a environ 1500 ans.

On attribue à Wihelm Schickard (1592-1635) la première machine à calculer de l'histoire. Il construisit en 1623, une horloge à calcul capable d'exécuter les quatre opérations selon un moyen purement mécanique. Cette machine unique sera détruite dans un incendie en 1624 et jamais reconstruite.
Blaise Pascal (1623-1662) construit en 1642, à l'âge de 19 ans, une machine qu'il appellera la Pascaline. Son invention avait le but de simplifier les interminables calculs administratifs de son père, surintendant de la généralité de Rouen.
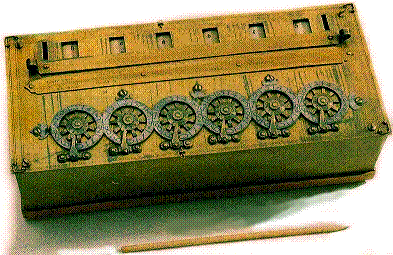
La Pascaline
La machine de Pascal possède un report automatique utilisant un dispositif mécanique composé d'une série de roues dentées, numérotées de 0 à 9 et reliées de telle manière que la rotation de l'une d'elle entraîne l'avance d'un cran sur la suivante. Pascal dira:
Pensées, 486
La machine de Pascal avait des limites toutefois. Multiplication et division étaient possibles mais au prix de nombreuses interventions humaines par manque de mécanismes appropriés. C'est à Liebniz que les machines à calculer devront le plus.
Gotfried Wilhelm Leibniz, sans connaître les travaux de ses prédécesseurs, réalise deux prototypes, l'un en 1694 et l'autre en 1704, d'une calculatrice capable d'exécuter toutes les opérations arithmétiques élémentaires par des moyens purement mécaniques. Les performances de l'horlogerie d'alors ne permettent pas la réalisation de machines efficaces toutefois et ce sont ses idées donc qui ont surtout circulé, récupérées par nombre de chercheurs pour lesquels la solution de Pascal ne convenait pas.
Sur le plan technique, sa calculatrice apporte de nouvelles solutions dont un inscripteur permettant de poser un nombre avant l'addition, un chariot pour la soustraction en position fixe, la multiplication en position mobile orientée vers la gauche et la division orientée vers la droite.
Les machines de Leibniz ne furent jamais commercialisées. Il fallut attendre le XIXe siècle pour voir des machines calculatrices capables de réaliser des tâches courantes. La révolution industrielle amena avec elle un besoin de nombres plus précis ainsi qu'une nouvelle classe de lettrés: les commis-comptables Ce sera l'âge de la mécanique et de la vapeur et l'on tentera de mettra au point des machines qui soient pour la première fois, à la portée de tous donc simples et efficaces, permettant une fiabilité dans les opérations.
Charles-Xavier Thomas de Colmar est Français et ingénieur. Il invente en 1820 une calculatrice qu'il appelle arithmomètre. Cette machine hérite des principes mis de l'avant par Leibniz auxquels sont ajoutés entre autres un effaceur et un bloqueur, pour retenir la réponse à une opération voulue. Il améliore et perfectionne les divers dispositifs mécaniques permettant pour la première fois des calculs fiables. Sa machine, la première commercialisée à grande échelle marque une étape dans l'histoire du calcul mécanique.
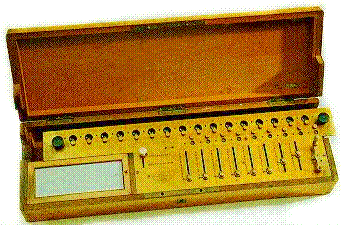
L'arithmomètre de Thomas
D'autres machines suivront et dans la seconde moitié du XIXe, l'Américain Frank S. Baldwin se fera remarquer dans le domaine de l'industrie des machines à calculer américaine ainsi qu'un Suédois, Wilgott T. Odhner, établi en Russie. D'autres arithmomètres verront le jour, poussant encore plus loin les limites de l'appareil. Mais la révolution restait encore à venir, qui permettrait des machines aux calculs rapides et plus automatiques. Car le calcul demeurait encore long guère plus rapide que fait par un calculateur humain.
Et c'est au clavier numérique qu'on doit le passage à la rapidité d'exécution. En effet, toutes les entrées de données requerraient encore beaucoup d'attention de la part de l'opérateur. Il devait déplacer avec précision un curseur pour inscrire chacun des chiffres entrée ce qui devenait exigeant à la longue. L'utilisation d'un clavier numérique put rendre ces opérations plus automatiques.
La première calculatrice utilisant un clavier est apparue vers 1850 en Amérique. David D. Parmalee avait alors inventé une machine qui n'eut pas de suite parce qu'elle n'était pas assez performante. Munie d'un totaliseur à roue unique, elle ne pouvait réaliser que des additions de nombres d'un seul chiffre.
C'était donc un retour en arrière. Plusieurs perfectionnements s'ajoutèrent dans les années qui suivirent mais ces machines demeuraient longue et difficile d'opération, demandant de nombreux gestes préparatoires ainsi qu'une grande attention de la part de l'opérateur.

Diverses machines calculatrices verront le jour jusqu'au début du XXe siècle, perfectionnant les divers dispositifs, réduisant la taille du clavier. Un innovation importante fut la mise en place d'un dispositif d'impression qui permettait de "lister" les diverses opérations et entrées de données dans la calculatrice. Ces dispositifs traceront le chemin des caisses enregistreuses.
La National Cash Register (NCR) fut fondée en 1884. Cette compagnie prit rapidement les devants dans le marché des caisses enregistreuses, perfectionnant et mettant diverses fonctionalités de celle-ci dont la production du relevé de caisse imprimé, la bande de papier récapitulative, la caisse enregistreuse à tiroirs multiples (avec sonnettes à sonorités distinctes) etc.
Depuis Leibniz, les machines à calculer doivent, pour multiplier, utiliser un procédé mécanique d'additions successives. Ces opérations, à cause de l'utilisation du clavier à touches, demandaient toujours moins de temps que le calcul traditionnel mais nécessitaient toujours un nombre important d'opérations. La multiplication directe fut démontée possible par Ramon Verea, un Hispanique résidant à NewYork en 1879. Mais celui-ci ne s'intéressant pas à la commercialisation du produit, c'est la machine de Bollée qui sera mieux connue.
Le Français Léon Bollée, déjà connu pour l'invention de la première voiture automobile à essence (et organisateur des premières rencontres des 24 heures du Mans) mit au point en 1888 une machine à capacité étendue. Cette machine pouvait travailler sur des nombres à plusieurs chiffres, réaliser naturellement des additions et des soustractions, des divisions et même des calculs d'intèrêts ou de racines carrés. Mais c'est sur la multiplication qu'elle remportait la palme, procurant des économies de temps allant jusqu'à 80% en rapport aux autres machines de son temps.
Le secret de la machine de Bollée résidait dans l'utilisation de tables de multiplications. Cette machine se mérita une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris en 1889. Cette machine était relativement complexe toutefois et ne fut jamais produite en grande quantité. Les machines suivantes résoudront ce problème et progressivement sera atteinte l'automatisation complète des quatre opérations.
Le début du XXe siècle s'occupa donc à régler les problèmes qu'amenaient la cohabitation des opérations de multiplication et de division directes. Les machines prirent de la vitesse et de l'exactitude. On put travailler avec de grande nombres. Les développements de la technologie ainsi que l'essor produit par les guerres produiront de nouveaux matériaux qui joueront finalement sur la taille des machines.
La première calculatrice mécanique portative fut la Curta, inventée par Kurt Herzstark du Liechtenstein. Elle fut inventée en 1948 et fut utilisée jusque dans les années 1970 où l'électronique la supplanta définitivement.
La possibilité de convertir l'énergie électrique en travail mécanique changera toutefois toutes les règles du jeu. Thomas Edison (1847-1931) fut le premier à électrifier une machine à écrire dans les années 1880. Pour les machines à calculer, il fallut attendre l'année 1910 pour voir apparaître des versions électriques motorisées des divers modèles présentés précédemment dont la caisse enregistreuse de NCR. Les premières furent regardées comme des curiosités mais il ne fallut pas longtemps pour que s'avère importante la contribution que l'électricité pouvait apporter à l'action des divers mécanismes d'entraînement des machines.
Mais l'apport de l'électricité amènera aussi une nouveau problème, sur le plan de la connaissance celui-là, qui opposera le calcul analogique au calcul numérique. La plupart des problèmes reliés aux opérations arithmétiques courantes ayant été résolus, des problèmes jusque là reportés à la spéculation intellectuelle purent surgir à nouveau établissant de nouveaux défis pour une technologie en pleine expansion.
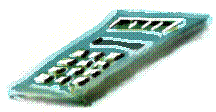
Et c'est ici que le domaine du calcul se confond avec celui de la pensée symbolique et
que des rêves de machines toujours plus puissantes prennent le nom d'ordinateur.